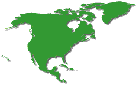|
Il n'y a prospérité économique que s’il y a concurrence, liberté des
prix et possibilité d’offrir produits et services profitablement.
Or l’État est incapable de susciter la prospérité, car il exclut ces moyens
qui seuls permettent de l’établir. Quand bien même on
redéfinissait la prospérité de façon à inclure la « prospérité de
l’âme », dans le but sous-entendu d’exclure la quête de profit de
la gestion des services, on ne pourrait davantage en conclure que
l’État est plus apte à les gérer. Non seulement la gestion
bureaucratique n’est pas apte à générer la prospérité parce
qu’elle impose le contribuable plutôt que de lui offrir un prix,
mais justement parce qu’elle procède ainsi elle conduit plus
sûrement à l’insatisfaction générale due à l’appauvrissement qui
s’ensuit.
|
La gestion bureaucratique comme source de conflit |
Un peu partout dans les démocraties on constate que les grèves
sont beaucoup plus nombreuses au sein des fonctions publique et
parapublique. Est-ce parce que les fonctionnaires et employés du
secteur parapublic sont moins accommodants que les travailleurs du
secteur privé? Le taux élevé de syndicalisation du secteur public,
81% au Québec, 75% au Canada, y est certainement pour quelque
chose. Toutefois, il ne faudrait pas blâmer uniquement les syndicats
pour cet esprit de confrontation, mais aussi, voire surtout, le
mode de gestion utilisé.
Lorsqu’on travaille pour un monopole ou quasi-monopole d’État et
qu’on exige une augmentation de salaire, ou bien le gouvernement
cède aux revendications pour maintenir les services touchés, ou
bien il n’y cède pas, mais dans les deux cas les consommateurs
écopent. Les fonctionnaires et employés du secteur parapublic
risquent peu de perdre leur emploi à faire la grève puisqu’ils
sont bien protégés par leur syndicat et, surtout, parce que le
gouvernement empêche les gens d’offrir les mêmes services dans le
secteur privé. Les employés du secteur privé ne possédant pas la
protection légale sous forme de monopole d’État ont donc plus à
perdre lorsqu’ils déclenchent une grève. Les consommateurs peuvent
se diriger vers les compétiteurs, l’entreprise peut s’établir
ailleurs, faire faillite, etc.
Ces monopoles ou quasi-monopoles sont établis d’après une
idéologie qui vise à diaboliser la quête de profit et à
promouvoir une conception éthique s’établissant sur la contrainte. Or, comment peut-on prétendre à
la justice et à la solidarité lorsqu’on utilise des moyens
contraignants pour les établir? C’est que les gens nient cette
coercition ou encore tentent de la justifier en prétextant qu’il
faut taxer et imposer pour aider, que si on ne taxe pas, il n’y
aura pas suffisamment de gens qui aideront autrui, etc. On tend
également à qualifier cette aide de «morale» pour détourner
l’attention de la coercition qui en est le fondement.
On ne peut prédire qui bénéficierait et qui serait désavantagé, à
court terme, d’être rémunéré seulement par les consommateurs
plutôt que par les contribuables, mais chose certaine on
n’assisterait pas aux grèves à répétition du secteur public. À
long terme, une privatisation entière de tous les services et le
respect de cette propriété serait à l’avantage de tous, car les
ressources humaines et matérielles ne seraient employées au détriment
de personne. Les choix établis ne seraient certainement pas
rentables pour tout le monde, mais ils auraient l’avantage de ne
pas être aussi destructeurs de richesse que les choix exercés par
les gouvernements. En effet, aussi mauvais que soient les calculs
d’un individu, ils ne peuvent avoir un impact que sur lui-même.
Une gestion qui ne tient pas compte des choix de chacun, ou qui ne
cherche pas à être profitable pour chaque individu, ne peut
utiliser à bon escient les ressources dont elle dispose. Encore une
fois, l’amélioration d’un service public ne peut s’établir qu’au
prix d’une réduction des produits et autres services qui peuvent
être considérés plus importants par certains individus. Par
conséquent, une gestion bureaucratique ne peut satisfaire les
besoins des gens aussi bien qu’une gestion privée, car elle ne
respecte pas la propriété, ne se laisse pas guider par les prix et
ne recherche pas les profits. Elle exproprie et manipule les
premiers et juge indigne les seconds.
Dans la mesure où il y a concurrence dans l’offre des services, le
consommateur détermine en bonne partie le prix de ces services et
la rémunération de celui ou celle qui les octroie. Plus la
concurrence est forte, c’est-à-dire plus les choix des services
sont nombreux, moins il y a de grève, celle-ci risquant de se
faire davantage au détriment des employés que des consommateurs.
Dans pareille circonstance, la gestion des services désirés par
les consommateurs est prise en charge par des gens tout aussi
dévoués que les travailleurs du secteur public, mais qui tentent
d’améliorer les services en se laissant guider par les prix que
les consommateurs sont prêts à leur offrir. Ce pourrait être les
mêmes gens offrant les mêmes services, qui recevraient un salaire
plus ou moins élevé que leur emploi comme «fonctionnaires», mais
qui le recevraient directement
des consommateurs plutôt que des contribuables.
En somme, aider autrui ne suffit pas, car encore faut-il utiliser
des moyens légitimes pour ce faire. La légitimité ne saurait se
contenter de la légalité des moyens utilisés. Une action légale,
mais illégitime, ne sera jamais aussi efficace qu’une action
respectueuse de la propriété. Éthique et prospérité sont
indissociables.
On ne gère pas avec plus de « compassion » lorsqu’on contrôle les
prix des services et qu’on exclut la possibilité de les offrir
profitablement ou selon les goûts de chacun. Ce faisant, on agit
plutôt comme un myope, à tâtons, sans être capable de voir plus
loin que le bout de son nez. Non seulement la gestion
bureaucratique n’est pas apte à produire la richesse, mais elle ne
peut la distribuer aussi bien qu’une gestion privée. De plus, elle
engendre la confrontation plutôt que la coopération. La solution
aux grèves à répétition dans le secteur public et à
l’insatisfaction des besoins ne peut être autre qu’une gestion
privée et respectueuse de la propriété.
|