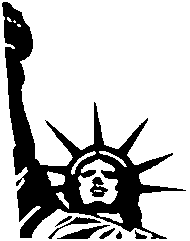Centesimus Annus loue en particulier l'homme innovateur, Il y donc lieu de distinguer l'enseignement sain et analytiquement fondé de l'Église universelle des doctrines faciles et superficielles d'une large partie de l'élite cléricale de chez nous. Notre Église locale baigne le plus souvent dans l'électoralisme et l'incohérence, en prônant le recours étendu aux pouvoirs publics pour transférer la richesse des uns aux autres, pour créer de l'emploi et stabiliser l'économie. Les diplômés du cours classique se souviennent que la parabole du bon Samaritain, du moins telle qu'enseignée par nos directeurs spirituels, soulignait que la charité désignait un acte individuel, le sacrifice de soi pour le bien d'autrui. Le message à gogo des évêques parle maintenant de lois et de programmes gouvernementaux, de justice sociale par l'action politique, de charité publique avec l'argent des autres. On attend toujours qu'on nous démontre les fondements évangéliques de ces fétiches doctrinaux. Qu'il suffise de souligner le contraste entre ces doctrines go-gauches et le message de don de soi qu'on prêchait en 1950 aux étudiants des collèges. Saint Vincent de Paul doit se retourner dans sa tombe. Il faut convenir malheureusement que la Faut-il conclure à l'impossible doctrine sociale de l'Église? Vraisemblablement. L'enseignement chrétien s'adresse aux cœurs et aux esprits des hommes, non pas aux institutions humaines qui les traduisent. Lorsque l'Église hiérarchique se permet de déborder ce territoire spirituel, elle perd son autorité et s'assimile dès lors aux groupes de pression, voire même aux partis politiques. Comme elle ne possède pas de compétence particulière pour analyser les institutions, elle risque de verser dans l'incohérence et l'ineptie, comme en témoignent plus d'une lettre des évêques canadiens sur l'économie. C'est le cas de la doctrine corporatiste, plus ou moins officialisée depuis Rerum Novarum et Quadragesimo Anno. Dans cette perspective, les L'Église est manifestement mal placée pour analyser les institutions sociales, l'administration publique en particulier. Sauf si le jugement est évident, comme c'est le cas du nazisme, du marxisme ou de la multitude de versions du collectivisme généralisé. Il était facile aussi de condamner la La culture collectiviste dominante a, à ce jour, interdit à l'Église de proclamer que si le marché n'est pas en soi une institution chrétienne, il est le seul mode d'organisation conciliable avec le christianisme. Les paragraphes qui suivent sur la neutralité éthique du capitalisme devraient pourvoir inspirer les évêques et le Saint-Père pour leur prochain mandement sur la société. La neutralité éthique du capitalisme Les bons économistes savent depuis Robins (1932), certainement depuis Becker, que la rationalité postulée par la discipline économique n'implique pas de calcul mesquin, qu'elle incorpore l'altruisme tout autant que l'égoïsme parmi les finalités des acteurs sociaux, qu'elle ne fait qu'exprimer la cohérence des gens. Les agents économiques poursuivent des finalités variées; ils maximisent leur utilité, point. Si bien que le souci d'aider les autres appartient tout autant que l'égoïsme et la malice à la fonction d'utilité. La proposition clé de l'enseignement économique est donc la suivante: Les vertus de coordination et de croissance du mécanisme marchand seraient rigoureusement les mêmes, ne différeraient pas d'un iota dans une société peuplée d'acteurs saints et purement altruistes. Qu'on se trouve en présence d'une économie composée d'agents parfaitement désintéressés ou au contraire peuplée des plus mesquins et matérialistes calculateurs, la théorie économique n'aurait rien à changer à son enseignement. Le marché est neutre vis-à-vis les finalités poursuivies par ses participants. Pour le démontrer, peut-être n'est-il pas superflu de faire l'exercice formel d'une économie libre imaginaire, peuplée de saints hommes engagés dans la seule production de services philanthropiques. La pensée conventionnelle prédirait qu'alors le régime de prix associé au marché s'effondrerait par suite de l'absence du mobile Or cette logique est foncièrement fausse. Le fait est que la recherche du rendement maximum, et donc le souci de payer les salaires les plus bas et d'obtenir les prix les plus hauts, caractériseraient la société d'altruistes, exactement comme la nôtre. Les incitations resteraient les mêmes. Sans doute les profits ainsi réalisés par notre communauté de saints hommes seraient-ils affectés à des objets nobles et philanthropiques, plutôt que de servir les fins souvent égoïstes et matérialistes des hommes réels. Mais, c'est là la seule différence. Ainsi l'entrepreneur voué à la seule fin de supprimer les ravages d'une maladie maximiserait les profits, de façon à consacrer le maximum de ressources à ce louable objectif. Toutes les autres finalités seraient subordonnées à cette fin, y compris le bien-être des employés et le niveau de vie de ses clients. Rien dans cette logique n'implique qu'il n'ait aucun souci du bien-être de ses employés ou de ses clients, seulement que dans sa fonction d'utilité il les range plus bas. En réalité, cette logique confirme ce que l'analyse postule: la maximisation du profit n'est que l'objectif instrumental. Et les saints et les pécheurs recherchent le profit; ils ne diffèrent que par l'usage qu'ils font du profit réalisé. Le mobile profit repose, non pas sur un postulat matérialiste et égoïste, mais sur l'omniprésence de finalités, de buts de la part des agents. Le profit de l'entrepreneur n'est jamais la fin ultime de ses efforts, de ses accomplissements. Il ne fait que servir à ses yeux la poursuite de ses objectifs ultimes de consommation. La moralité ou l'immoralité de la recherche du profit dépend entièrement de la moralité ou de l'immoralité des objectifs de consommation recherchés. La leçon d'analyse qu'enseigne l'économique est donc que le capitalisme est un régime éthiquement neutre, qu'il favorise la réalisation efficace de finalités de toutes les couleurs éthiques, dont les finalités chrétiennes. Il faut ajouter maintenant qu'en un sens le régime capitaliste protège la société contre les torts découlant des tendances malicieuses d'un grand nombre de ses membres. S'il est vrai que les participants du marché peuvent s'adonner à toutes sortes de comportements déplorables, il est aussi vrai que le régime de droits de propriété inhérent à la concurrence capitaliste interdit aux égoïstes et aux immoraux de refiler le poids de leurs faiblesses et de leurs dépravations à leurs voisins. Dans un régime où les droits de propriété sont protégés et donc exclusifs, l'appât du gain, l'envie ou la malice, si peu exemplaires qu'ils soient, ne représentent aucun danger pour les autres et s'avèrent anodins. En l'absence de droits de propriété par contre, c'est-à-dire là où l'allocation et le partage des ressources se font par l'État monopole, l'appât du gain des uns retire par la force aux autres l'accès aux ressources rares et ainsi leur transfère le fardeau de leur égoïsme. La vaie nature du capitalisme On trouve l'illustration la plus convaincante de cette dynamique dans les phénomènes de sexisme et de racisme, si décriés de nos jours. L'employeur imbu de préjugés sexistes et racistes est impuissant à refiler le coût de ses préjugés à ses employés ou à ses clients. En se privant d'une main-d'œuvre productive et peu chère pour des considérations sexistes ou racistes, il se pénalise lui-même, réduit ses profits et prête flanc à la concurrence éventuelle des employeurs libres de préjugés, qui ne tarderont pas à la supplanter sur le marché de la consommation et du capital. En régime de concurrence capitaliste, les préjugés sont sans importance, parce que les victimes potentielles peuvent toujours trouver à s'employer chez le producteur voisin. Au contraire, dans les secteurs d'activités monopolisés par l'État ou cartellisés par ses réglementations (cartels d'entreprises comme le taxi ou de travailleurs comme les monopoles syndicaux coercitifs), les préjugés de l'employeur sont en quelque sorte récompensés en ce que lui, l'employeur, n'en porte pas le fardeau, qui est plutôt refilé aux employés victimes de préjugés en salaires réduits et en occasions d'emploi rétrécis. En monopolisant l'économie, l'État confère à des groupes le pouvoir de transférer le coût de leur égoïsme et de leurs préjugés à leurs victimes. Ils l'exploiteront allègrement. Le capitalisme sert donc d'instrument pour minimiser les conséquences de ce que les hommes ne soient pas des saints, et donc qu'ils ne poursuivent pas toujours des fins nobles. Les conséquences de la mesquinerie des hommes sont sans effets sur leurs voisins en régime de marchés, tant que l'État ne confère pas de pouvoir de monopole aux uns et aux autres, c'est-à-dire le pouvoir de refiler aux autres le poids de leur malice. Les do-gooders déploreront peut-être que les finalités ultimes soient en fait matérialistes, qu'il faut donc changer l'homme, et substituer par l'État des finalités philanthropiques à la mesquinerie des hommes. Outre que cette ambition est parfaitement utopique, comme le confirme l'histoire des totalitarismes du XXe siècle, on doit reconnaître qu'une société n'est jamais plus altruiste que ne le sont ses membres. Aucune organisation sociale ne peut se construire sur le postulat de la compassion universelle, de l'amour. L'illusion que les gens seront plus généreux par l'État que par le marché n'est qu'une illusion. Parce que la logique de l'État repose sur le redistributionnisme forcé en faveur des groupes les plus puissants, l'allocation par l'État devient moins vertueuse que ne l'est la population elle-même. La prospérité capitaliste, elle, est indépendante des principes éthiques de ses participants. Et la vertu globale est au moins aussi grande qu'elle ne l'est chez les individus. (*) Ce texte s'inspire d'un exposé fait par Israel M. Kirzner aux assises de la Société Mont-Pèlerin, à Cancun, en janvier 1997.
|