| Montréal,
le 12 juin 1999 |
Numéro
39
|
 (page 7)
(page 7) |
 page précédente
page précédente
Vos
réactions
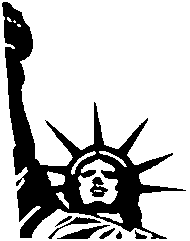
« Opportunity is missed by most people because it is dressed
in overalls and looks like work. »
Thomas Edison
|
|
|
BILLET
L'EXCLUSION SOCIALE
par Brigitte Pellerin
Il fait beau, il fait chaud, c'est le Tour de l'Île et les automobilistes
apprennent à prendre leur mal en patience. La ville est complètement
jammée, la Main est bloquée pour cause de vente trottoir,
les stationnements sont devenus impossibles à dénicher tellement
il y a de banlieusards en ville. Bref, Montréal est le royaume du
road-rage.
Ce qui me fait dire: marchez, que diantre. Vous n'avez pas idée
de ce que vous manquez assis derrière votre roue, suant sang et
eau dans votre minoune. Tellement préoccupés par le finger
que vient de vous envoyer le tata dans la Tercel rouge toute bossée,
vous perdez de vue le plus beau du paysage urbain qui s'offre gratuitement
à vos yeux. Pour percevoir les choses sous un autre angle, il faut
nécessairement changer ses petites habitudes pépères.
Si je vous dis ça, c'est que j'ai récemment fait une découverte
qui m'a jetée en bas de ma chaise. Eh oui, on dirait pas comme ça,
mais la ville est encore pleine de choses à découvrir. Oh,
rien de bien nouveau sous le soleil; juste quelque chose que je n'avais
pas encore remarqué. |
|
Dans ma ville y'a des belles choses à
voir...
C'est l'autre après-midi que la révélation m'a frappée
de plein fouet. Je déambulais tranquillement dans les environs du
Carré Saint-Louis (eh oui, les horaires flexibles ont quand même
leurs avantages) et je m'amusais à scruter les gens qui jouissaient
langoureusement du soleil et de la Molson Dry bien écrasés
sur les bancs de parc.
Vous savez comme on peut facilement spotter les prestataires de la charité
publique dans une foule. Ils sont reconnaissables à la camisole
au coton avachi qu'ils portent sans complexe, à la bedaine qui trône
fièrement sous ladite camisole, au teint blafard qu'ils arborent
et aux cigarettes qu'ils fument l'une sur l'autre. Bref, ils n'ont pas
l'air bien.
Oui, je généralise. Et sans gêne avec ça. Mais
l'important de l'affaire, c'est que j'ai soudainement réalisé
la semaine dernière ce que voulait dire « exclusion
sociale ».
Les exclus, ce sont ceux qui, à force de recevoir des sous à
ne rien faire, se font enlever leur identité. Les exclus sont ceux
à qui les bonnes âmes, à force de généreuses
intentions mal inspirées, enlèvent tout sentiment d'utilité,
ce qui les prive d'une bonne raison de se lever le matin.
D'où je tiens cette idée? D'un bouquin qui s'intitule Escape
from Freedom, d'Erich Fromm, publié pour la première
fois en 1941 et qui ne cesse d'être réédité
depuis. Un classique dont je recommanderais très fortement la lecture,
si seulement on me demandait mon avis.
|
« Les
prestations d'aide sociale, en plus de coûter une fortune à
ceux qui se grouillent pour gagner leur croûte, ne font que pousser
les sans-emploi dans un cercle vicieux d'inutilité-insignifiance-déprime.
»
|
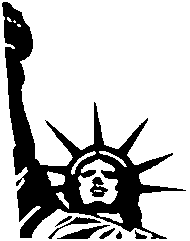
|
Fromm fait une distinction entre les besoins dits flexibles, c'est-à-dire
qui peuvent s'adapter à l'environnement, et les autres besoins,
dits primaires. Par exemple, l'amour, l'attrait du pouvoir, le sadisme,
la jouissance pure et simple des bienfaits de la vie, ou l'ambition sont
des besoins qu'on a ou n'a pas – à degrés variables –, et
qui s'adaptent à l'environnement de chacun. La pauvre nonne cloîtrée
doit bien se rabattre sur le bon Dieu, pour ceux qui préfèrent
une image à une suite d'exemples. Ça va? Vous y êtes?
OK.
Les autres besoins, dits primaires ou impératifs, se moquent bien
des conditions environnantes. On a tous besoin de manger, de boire, de
dormir. Ces besoins sont conditionnés, et on ne peut y échapper
bien longtemps. Avant de penser à jouir des plaisirs de la vie,
il faut d'abord assurer notre survie. Pour Fromm, la satisfaction de ces
besoins indispensables à notre préservation forme ce qu'il
appelle les motivations primaires du comportement humain.
En d'autres mots, l'homme (ou sa voisine) doit manger, boire, dormir, se
protéger des ennemis (lire: l'hiver), etc. Pour accomplir tout ça,
l'homme doit travailler à produire quelque chose. Que ce soit directement,
comme par exemple sur la ferme, ou indirectement dans n'importe quel autre
domaine où il utilise l'argent gagné pour satisfaire ses
besoins primaires.
Bon. Avant que vous ne me lanciez des tomates pour vous ressasser d'aussi
banales vérités, je vais poursuivre avec le déroulement
intéressant de l'analyse d'Erich Fromm.
Cet indispensable sentiment d'appartenance
L'obligation de produire, ou de travailler, situe chaque individu par rapport
aux autres, par rapport à l'environnement. Le travail donne à
l'individu un certain sentiment d'appartenance, ou à tout le moins
une place dans la société au milieu de laquelle il évolue.
Sentiment d'appartenance, ou d'utilité que, vous vous en doutez
sûrement, n'ont pas les gens qu'on paie à ne rien faire.
Selon Fromm, ce sentiment d'appartenance ou d'utilité est indispensable
si on veut éviter de tomber dans l'isolement moral. Ce qu'il entend
par isolement moral, c'est l'absence de ce sentiment de coopération
avec les autres personnes qui nous entourent. Les pauvre bougres qui sont
privés de cette coopération essentielle ont beaucoup de difficulté
à se reconnaître en tant qu'« individus
à part entière » et ont tendance à
sombrer dans la dépression lorsqu'ils réalisent à
quel point ils n'ont aucune signification pour les autres.
C'est donc dire que plus on essaie de rendre la situation des sans-emploi
moins pénible en leur donnant des sous sans rien leur demander en
retour, plus on les pousse vers la déprime profonde qui accompagne
forcément l'isolement moral.
Résultat? Pas beau tu-suite. Les prestations d'aide sociale, en
plus de coûter une fortune à ceux qui se grouillent pour gagner
leur croûte, ne font que pousser les sans-emploi dans un cercle vicieux
d'inutilité-insignifiance-déprime. Plus ils réalisent
qu'ils sont inutiles, plus ils s'aperçoivent avec détresse
qu'ils pourraient disparaître demain matin sans que le monde ne s'en
porte plus mal. Forcément, de telles idées finissent par
leur donner les bleus, avec pour résultat qu'ils se cherchent encore
moins un façon de s'en sortir. Et roulez-roulez, petits bolides.
Plus ils sont déprimés, plus ils ont l'air malheureux (comprenez-vous,
maintenant, pourquoi ils sont si facilement reconnaissables?), et plus
ils ont l'air malheureux, plus les bonnes âmes accourent pour leur
filer encore un peu plus de sous. Pour les « aider »,
soi-disant.
Pas à dire, y en a qui sont durs de comprenure.
Articles précédents
de Brigitte Pellerin |
|