L'an dernier, la SODEC a redistribué 32 millions de nos dollars
aux entreprises culturelles. On s'en doute, il ne se fait pas grand-chose
de culturel dans notre belle province sans que la facture ne nous soit
refilée. Mais voilà que certains artistes moins bien choyés
que d'autres par le système en place – c'est le cas des artistes
de la contre-culture (ou de l'underground) – se sentent de plus
en plus laissés pour compte. La raison: les organismes comme la
SODEC ne font affaire qu'avec des entreprises culturelles officiellement
établies et non des individus. Une situation sur le point de changer
si on se fie aux propos de M. Lampron.
Accéder à l'underground
Récemment, à l'émission Les règles du jeu
diffusée sur les ondes de Télé-Québec(2),
les membres de la formation alternative montréalaise Caféine
et les bodums! dénonçaient le système québécois
d'attribution de subventions qui les empêche de recevoir une aide
gouvernementale alors que des artistes établis comme Richard Séguin,
Jean-Pierre Ferland ou Robert Charlebois se la coulent douce en encaissant
à répétition des montants dont ils n'auraient plus
vraiment besoin (« il s'agit d'être subventionné
une fois pour l'être une seconde fois, puis une troisième
fois, puis une dixième... »). Ils se plaignaient
aussi de leurs pauvres conditions de travail (« on doit
être 50% routier, 25% musicien et 25% homme d'affaires... »)
qui font en sorte qu'ils ne peuvent se consacrer entièrement à
leur art.
Pour obtenir une aide de la SODEC, ou de Musiaction, le pendant fédéral
de l'organisme québécois, et être admis au sein de
la très grande famille des subventionnés, Caféine
et les bodums! devrait passer par une maison de disques officielle (aucune
ne veut d'eux) ou mettre sur pied sa propre étiquette pour ensuite
se dénicher une compagnie de distribution prête à s'occuper
d'eux (investissement trop important pour une formation dont les ventes
du 1er album ont plafonnées aux alentours de 2000). Que faire? Changer
de style musical ou persévérer?
Définir l'underground
La contre-culture, comme son nom l'indique, est un genre qui va à
l'encontre des règles commerciales et esthétiques établies.
L'artiste underground a une vision des choses et une façon d'en
rendre compte qui ne rejoint donc pas nécessairement celle du consommateur
moyen. Pour ces raisons, très peu de gens achètent les produits
de la contre-culture – le consommateur moyen, voulant être certain
de bien saisir ce dont il est question lorsqu'il investit temps et argent
dans un produit culturel, préfère de loin les produits grand
public et facilement accessibles à tous aux produits plus spécialisés.
La clientèle de l'artiste underground est constituée
de gens qui, comme lui, vivent un peu en retrait de la dite «
société de consommation » et qui
recherchent autre chose que le xième film de meurtres en série...
la millième chanson pop qu'on ne peut plus entendre un mois après
sa sortie... les interminables séries télévisées
consacrées à des gens physiquement parfaits qui passent le
plus clair de leur temps à discuter de banalités interpersonnelles...
Artistes et clients ne cadrent pas avec le portrait type du consommateur
culturel moyen tel qu'élaboré dans de nombreux sondages,
recensements et focus groups.
|
« C'est
parce que des individus voient des possibilités là où
ils investissent temps et/ou argent que la culture évolue.
»
|
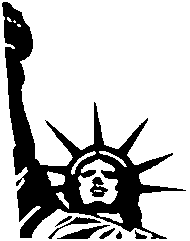
|
Mais voilà que ces artistes de l'underground qui ne cadrent
ni avec le discours culturel officiel, ni avec les critères d'admissibilité
aux nombreux programmes d'aide à la création, pourront être
« récupérés » en quelque
sorte par le système et ainsi jouer le jeu de la demande de subvention.
À défaut d'être assez vendables pour s'attirer un large
public d'admirateurs, ils pourront tranquillement continuer à créer
en dehors des circuits commerciaux grâce à l'argent de contribuables
qui n'entreront probablement jamais en contact avec leur art. Reste à
voir comment ils s'expliqueront cette douteuse affiliation...
Car si l'artiste de la contre-culture est, de pas sa nature, un être
contestataire qui n'en a rien à cirer des conventions et qui se
fait un devoir de dénoncer le capitalisme sauvage, la règle
de droit et les rudiments de la vie en société, comment pourra-t-il
s'expliquer le fait qu'il en soit réduit à être entretenu
par ce même « système » qu'il dénonce?
Comment pourra-t-il à la fois crier son indignation devant les injustices
qu'engendre le « système » et être
soutenu par une de ses composantes? N'y a-t-il pas là une contradiction
dans les termes? Hmm... Ou bien il tentera de se convaincre qu'il s'agit
là d'un de ses nombreux droits absolus, ou bien il fera abstraction
de la réalité... le temps de se constituer un auditoire.
Beau programme!
L'émergeant monopole
L'intrusion de la SODEC dans l'underground ne laisse rien présager
de bon. Un organisme gouvernemental qui se prétend mieux placé
que le public et les mononcles pour instaurer un climat propice à
l'éclosion de nouveaux talents doit être pris pour ce qu'il
est: une bébelle à gaspiller des fonds publics. Personne
ne détient le monopole du bon goût. Encore moins une bande
de bureaucrates affectés à la culture. Ce sont les consommateurs
qui, à chaque fois qu'ils achètent un disque, un billet de
spectacle ou un livre, décident de ce qui existera – ou disparaîtra.
Et de même que toutes sortes de gens consomment toutes sortes de
produits culturels parce qu'ils en retirent quelques bénéfices,
toutes sortes de gens investissent dans toutes sortes de projets parce
qu'ils y entrevoient des possibilités – des potentialités
non réalisées. C'est justement parce que des individus voient
des possibilités là où ils investissent temps et/ou
argent que la culture évolue. On n'a qu'à penser au film
d'horreur à petit budget Blair Witch Project. N'eût
été de la détermination d'une poignée d'individus,
ce projet qui allait à l'encontre des normes cinématographiques
commerciales n'aurait jamais vu le jour. Mais des individus ont cru au
projet et l'ont mené à terme – et les millions ont suivi.
Un bureaucrate n'aurait pas nécessairement vu son potentiel. Un
banquier non plus.
C'est que contrairement à ces bureaucrates qui doivent respecter
des listes de règlements pré-établis lors de l'évaluation
de projets qu'on leur confie, les « mononcles »
que tentent de remplacer M. Lampron et ses amies n'ont à
prendre en considération que les contraintes qu'ils se sont eux-mêmes
imposées et sont libres de faire ce qu'ils veulent de l'argent qui
leur reste (après impôt, bien entendu). Le jeune artiste qui
ne cadre pas dans les normes artistiques de l'heure a donc plus de chances
de recevoir des fonds d'un oncle excentrique que d'un organisme public.
À terme, une telle « ouverture » à
la contre-culture n'amènera qu'une déresponsabilisation des
artistes-en-devenir qui, au lieu d'angoisser à l'idée de
devoir rembourser une dette contractée auprès d'oncle Roger,
pourront comme les vieux se la couler douce et oublier celle contractée
auprès de la collectivité. Et tous ces oncles attentionnés
qui seraient tentés de venir en aide à leurs petits neveux
boutonneux n'auront plus à risquer leurs économies! Tous
ensemble, nous risquerons les nôtres.
Si la contre-culture forme les tendances culturelles de demain, on ne peut
espérer beaucoup d'une culture élaborée à partir
de tendances qui doivent a priori rencontrer une série d'exigences
et de critères d'admissibilité pour exister. À long
terme, l'intrusion de l'État dans l'underground ne peut produire
qu'une uniformisation et un appauvrissement de la culture. Messieurs-Dames
de la contre-culture, soyez conséquents!
1. Suzanne Colpron, «
La SODEC ouvre sa porte à la contre-culture »,
La Presse,
8 octobre 1999. >>
2. Jacques Taschereau, «
Le disque ne tourne pas rond », Les règles
du jeu,
Télé-Québec,
15 septembre 1999. >>
Articles précédents
de Gilles Guénette |