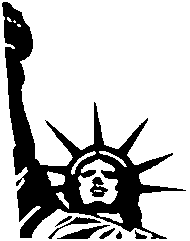
(Le Devoir, 21 novembre 1994)
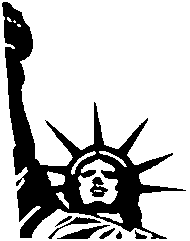
(Le Devoir, 21 novembre 1994) |
par Martin Masse
|
Le
préfixe
La Hollande du Siècle
d'or, dont on ne retient aujourd'hui que Rembrandt et Vermeer, Spinoza
et Descartes, fut la première société véritablement
libérale des temps modernes, le seul pays au XVIIe siècle
qui nous ressemble vraiment à de multiples égards. Depuis,
et grâce à la propagation des idées libérales,
tout l'Occident, et maintenant le monde entier, évoluent dans le
sens de ce qu'a été ce petit pays avant-gardiste.
Il y a évidemment
encore des poches de résistance ici et là, où l'on
souhaiterait maintenir un obscurantisme collectiviste de gauche ou de droite.
C'est le cas notamment dans le petit monde intellectuel québécois,
qui carbure surtout aux illusions de gauche.
L'excellent article de
Pierre Desrochers et Éric Duhaime sur les fondements du libéralisme
(Le Devoir, 4 novembre 1994) ne fait que mettre en lumière
cette réalité bien désolante. Alors que le communisme
est mort, que le socialisme et l'interventionnisme étatique ont
démontré leur faillite, que même les expériences
social-démocratiques les plus modérées s'effondrent
sous les dettes et les pathologies sociales, il faut encore, au Québec,
réinventer la roue et expliquer que le libéralisme n'est
pas une maladie honteuse. Expliquer que c'est le libéralisme qui
a engendré la civilisation moderne. Expliquer que les défauts
des sociétés libérales sont cent fois plus vivables
que les horreurs des régimes fondés sur des idéologies
concurrentes.
Il faut répéter
encore, pour tous nos amis
L'un des paradoxes les
plus étonnants de l'histoire récente du Québec est
que les événements des dernières décennies
aient été si propices à la création culturelle,
mais en même temps si défavorables aux débats d'idées
fondés sur la maturité et le pluralisme. Depuis 30 ans, on
pourrait compter sur les doigts de la main les essais et magazines intellos
qui ne s'inspirent pas de points de vue de gauche ou nationalistes.
Mon quotidien préféré,
Le Devoir, est censé être un reflet du monde intellectuel
québécois. Ces derniers mois, mis à part MM. Desrochers
et Duhaime, le professeur Jean-Luc Migué de l'ÉNAP et moi-même,
pratiquement personne n'a défendu des positions explicitement libérales
dans ses pages. Au contraire, le moralisme gauchiste domine les textes
de la page
L'éditorialiste
Jean-Robert Sansfaçon continue à poser des diagnostics plutôt
libéraux sur les questions économiques mais demeure réticent
à suggérer des solutions tout aussi libérales. En
revanche, Gilles Lesage a, lui, des solutions bureaucratiques dignes des
années 1970 à proposer chaque fois qu'il se penche sur les
problèmes de nos gouvernements.
C'est Hélène
Jutras qui a raison: les débats intellectuels au Québec ne
volent pas bien haut. Évidemment, en lieu et place d'une analyse
des causes de cette pauvreté, nous avons eu droit ces dernières
semaines à des échanges à teneur existentielle sur
l'opportunité pour la jeune Hélène de partir ou non
vers des pâturages plus verts, de trahir ou non sa tribu. Mais bon
Dieu! N'est-il pas normal d'éprouver ce genre de sentiments à
19 ans? Notre société n'est-elle pas assez adulte pour s'accommoder
de ces écarts inévitables de solidarité? Il semble
bien que non. Pas pour nos élites gardiennes du bien public en tout
cas, qui font toujours preuve de la même insécurité
maladive, du même nombrilisme nationaliste et de la même naïveté
gauchiste qui rendent incapables de dissocier l'individuel du collectif.
La réalité
québécoise et mondiale reflète de plus en plus une
vision du monde libérale, que cela plaise ou non aux