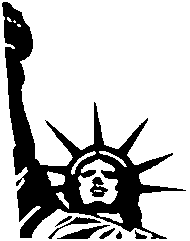| Montréal,
le 26 septembre 1998 |
Numéro
21
|
 (page 9)
(page 9)
 page précédente
page précédente
Vos
commentaires
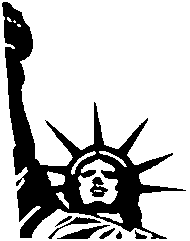
« Si
on subventionne, on ne va pas attirer les gens de talent, on va attirer
les gens qui ont le talent d'attirer vers eux des subventions. »
Daniel Pilon
|
|
MOT POUR MOT
POUR UNE CULTURE
NON SUBVENTIONNÉE
Daniel Pilon est de retour après un exil de plusieurs années
aux États-Unis. Longtemps absent de notre paysage cinématographique
et télévisuel, l'acteur maintenant dans la cinquantaine dit
revenir au Québec pour y élever ses enfants. Pour ceux qui
ne se souviennent pas de lui, il a joué dans des classiques du cinéma
québécois comme Quelques arpents de neige et La
mort d'un bûcheron dans les années 70 avant de déménager
ses pénates aux États-Unis. Il y a poursuivi sa carrière
au petit écran, dans des téléséries comme Ryan's
Hope et Dallas, et au grand écran, dans des films comme
Scanners III: The Takeover et Poltergeist: The Legacy.
Pilon est un des très rares artistes québécois à
afficher ouvertement son profond mépris pour la culture subventionnée.
Son discours est rafraîchissant dans une province où les artistes
et les artisans se serrent les coudes pour continuer à profiter
des nombreux programmes provinciaux et fédéraux. Voici un
extrait de l'entrevue qu'il accordait à Paul Arcand le 15 septembre
dernier dans le cadre de l'émision Bonjour Montréal
diffusée sur les ondes de CKAC: |
Paul Arcand: (...) Mais vous qui avez travaillé un peu partout –
bon beaucoup aux États-Unis –, quand vous comparez ce qui ce fait
ici, la production ici au Québec par rapport à ce qui se
fait, exemple, aux États-Unis...
Daniel Pilon: Si on compare les deux, sans qu'il n'y ait de zones communes
vous voulez dire, parce que dans les coproductions c'est un peu un mélange
des deux et ça se fait beaucoup plus à l'américaine.
Mais si on prend une production québécoise, ou une production
canadienne, entièrement canadienne et une production entièrement
américaine, là c'est vraiment le jour et la nuit.
P.A.: En termes de moyens?
D.P.: Ben non, en terme de façon, en terme d'approche, en terme
de concept. Au Canada, l'industrie de la culture, puis là j'emploi
le mot « culture » avec un... je ne sais pas trop
comment le décrire, mais c'est très vague. Quand on parle
d'identité culturelle au Canada, qu'est-ce que ça veut dire...
on ne sait pas trop. Et c'est parce qu'on ne le sait pas trop que ça
devient très vague aussi dans les projets et dans les financements.
Au Canada, tout est subventionné. Tout
est financé par les argents publics. Alors ça fausse le jeu.
Aux États-Unis, il y a les forces libres du marché libre
qui agissent. Même... même c'est le seul pays où – je
parle des États-Unis –, c'est le seul pays où le théâtre
n'est pas subventionné. Et c'est le seul pays où le théâtre
se porte à merveille.
P.A.: Mais alors quoi, vous êtes contre les subventions?
D.P.: Moi je suis absolument antisubvention, contre toute subvention, même
pas une petite subvention, je suis contre les subventions. Je ne suis pas
contre les projets pédagogiques de démarrage – le premier...
le petit gars qui a 21 ans, puis il vient d'écrire son premier scénario,
puis il est tout feu tout flamme, puis il veut apprendre, puis il ne sait
pas trop – oui, ça c'est un peu comme l'université. Donc,
le gouvernement, ou les argents publics, ou des fondations devraient, oui,
financer ça. Ça c'est normal. Mais quand ça fait 35
ans qu'un gars fait du cinéma, comprends-tu, et qu'on finance son
film encore à plein et qu'on sait très bien que ce film-là
n'ira nulle part, que le film ne fera pas une maudite cenne et qu'on finance
à cinq, six, sept millions d'argent public, ou que
le théâtre... On rabâche les mêmes vieilles pièces,
les mêmes vieilles affaires, on sait qu'il n'y aura pas de public
pour ça, que personne va payer... en fait... De toute façon,
mon ami Raymond Cloutier en avait parlé du théâtre
au Québec, il y a une population de 15 000 personnes
qui va au théâtre dans la grande région de Montréal
qui compte 3 millions d'individus, je veux dire... et c'est
financé à coup de... ça coûte à peu près
un million par mois à financer.
P.A.: Mais, vous savez que la réplique des gens du milieu du théâtre,
les gens de la production vont dire: « sans argent public,
les théâtres vont fermer, il n'y aura pas de productions,
on est un marché trop petit pour être capable de produire
sans aide publique. »
D.P.: Ok. À ça, on peut répondre la chose suivante,
qui est simple. C'est quand... on pourra dire ce qu'on pense ou ce qu'on
veut de M. Reagan, quand M. Reagan est arrivé... un
ultraconservateur... quand M. Reagan est arrivé en
1980, au début de son mandat, il y avait les gens qui s'occupaient
de ce genre de choses – je ne me souviens pas du nom de son secrétaire
qui s'occupait de la culture et des affaires culturelles, ce qui est théâtre
et cinéma et télévision – ils ont dit «
nous ce qu'on aimerait faire – et ils l'ont fait – on aimerait enlever
toutes les subventions parce qu'on considère que... »
et la logique était très simple. Je vais essayer d'être
lent pour que tout le monde comprenne. La
logique était que la recherche de l'excellence exige une compétition
féroce et il ne peut pas y avoir une compétition féroce
s'il y a des subventions. Ils ajoutaient même que si on subventionne,
on ne va pas attirer les gens de talent, on va attirer les gens qui ont
le talent d'attirer vers eux des subventions.
Ce qui ne veut pas dire que l'excellence du produit va être assuré.
Absolument pas, c'est le contraire. Alors au Canada, ce qu'il se passe,
c'est qu'on a un cercle très restreint d'individus qui attirent
vers eux toutes les subventions. Si on parle de théâtre, c'est
encore pire. Parce qu'au théâtre, non seulement ils sont payés
pour faire du théâtre, mais ils nous offrent un produit –
quand je dis nous, c'est le public – ils offrent au public un produit que
le public n'a pas demandé et ils ont le culot de leur demander d'acheter
un ticket pour aller le voir en plus. Ça je trouve que c'est un
petit peu trop.
P.A.: Mais ce que vous dites-là, pour prendre une image et résumer,
ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un petit groupe
dont le seul talent est d'être capable de remplir la paperasse pour
obtenir les subventions?
D.P.: Oui. Puis d'avoir aussi... je veux dire... d'avoir acquis pendant
des années les amitiés nécessaires, les alliances
très stratégiques à l'intérieur des gouvernements
et des ministères qui s'occupent de financer. En tout cas... quand
Sheila Copps a annoncé l'an dernier – c'était l'an dernier?
– elle était toute fière d'annoncer qu'il y avait 200
millions, DEUX CENT MILLIONS, un cinquième de milliard de
piastres qui s'en allaient à on ne sait pas trop qui finalement.
On finance à peu près n'importe qui.
P.A.: On ne sait pas trop qui, mais vous dites que ce sont toujours les
mêmes ou à peu près.
D.P.: Bien oui, mais là je ne veux pas accuser parce que, je ne
sais pas, ils vont peut-être m'attendre à la porte de CKAC.
Oui, il y a vraiment une petite... un petit groupe restreint d'individus
qui sont là depuis longtemps et qui... il y a des nouveaux arrivants
toujours, mais c'est une cercle où l'argent se promène et
ne sert pas vraiment. Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on veut
faire? On veut encourager une industrie, on veut encourager surtout, on
veut se démarquer des État-Unis. Le Canada anglais surtout
veut se démarquer des États-Unis. Et le Canada français
veut – j'ai pas dit le Québec –, le Canada français veut
vraiment souligner son identité culturelle. I-den-ti-té
cul-tu-rel-le, ça veut dire quoi? Tu
sais, quand on donne quatre ou cinq millions $ à un
cinéaste qui fait des navets depuis 20 ans, puis on lui donne un
autre 5 millions $ pour faire un autre navet, je comprends
pas.
P.A.: Mais est-ce qu'aux États-Unis, le système de cliques
n'est pas aussi réel? C'est-à-dire, il faut connaître
le producteur, il faut être ami avec un tel, ou tel financier, etc.
D.P.: Non, ça c'est pas pareil. Ça, ça s'appelle business.
Et les Américains disent « Give the
people what they want ». Il faut donner au monde,
au public, ce qu'il veut. S'il ne le veut pas, il l'achètera pas.
Et quand je parle de recherche de l'excellence, ça ne veut pas dire
les meilleurs documentaires de PBS – qui n'est pas financé d'ailleurs,
qui n'a aucun argent public. Il y a des argents de fondations à
PBS, au National Public Radio qui est un peu le CBC des États-Unis...
mais c'est entièrement privé ça. Et ça fonctionne
très bien. Je veux dire, les meilleurs documentaires au monde sont
produits par PBS – si on regarde des émissions comme Frontline
ou Nova –, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Mais en même
temps, quand je parle de recherche de l'excellence, ça veut dire
Wheel of Fortune aussi. Il y a un public qui achète Wheel
of Fortune. Et Wheel of Fortune est peut-être, dans son
genre, ce qui se fait de mieux.
P.A.: Ben, ce que vous nous dites, c'est que la culture québécoise,
au cinéma et au théâtre, n'est pas connectée
sur le public?
D.P.: Elle est pas connectée sur le public... et puis c'est devenu,
parce que... parce que les argents sont publics et parce que ce n'est plus
une question d'affaires. Moi si je veux financer un film, il faut que j'aille
voir mes backers, il faut que je trouve quelqu'un... d'ailleurs,
je ne peux pas le faire au Canada. Moi, je ne peux pas financer un film
au Canada.
P.A.: Pourquoi?
D.P.: Parce que, je n'irais pas chercher de subventions. Et il n'y a pas
d'argent public (sic) au Canada. Ce qu'on veut faire au Québec...
c'est malheureux – puis là encore, je vais me faire taper
dessus pour dire ça –, le cinéma n'est plus national. C'est-à-dire,
il y a pas de cinéma italien, il y pas de cinéma américain,
il y a pas de cinéma anglais, il y a LE cinéma qu'on produit
aux États-Unis, en Angleterre, en Italie, ou au Québec. Si
on doit produire un film au Québec, qu'on fasse un film qui puisse
s'ouvrir sur un marché international et à ce moment-là,
il va y avoir des banquiers et des hommes d'affaires qui vont être
prêts à mettre... Hey! Titanic, ça a fait combien
ça Titanic? Ben c'est tout de l'argent privé, ça.
Et tous les films américains, c'est
de l'argent privé. Puis quand tu te casses la gueule, c'est comme
n'importe qui qui fait faillite. Tu dis: « bon ben maudit,
on s'est fourré! » On n'a pas, on n'a pas bien
jaugé... notre produit n'était pas assez bon et le public
n'en voulait pas.
(...)
|